Pourquoi y a-t-il un "h" à bonheur ?
Découvrez l’histoire du mot bonheur : de son ancien “bon eür” médiéval à son mystérieux h muet, un voyage étymologique au cœur de la langue française
LA VIE SECRÈTE DES MOTS
12/11/20253 min read
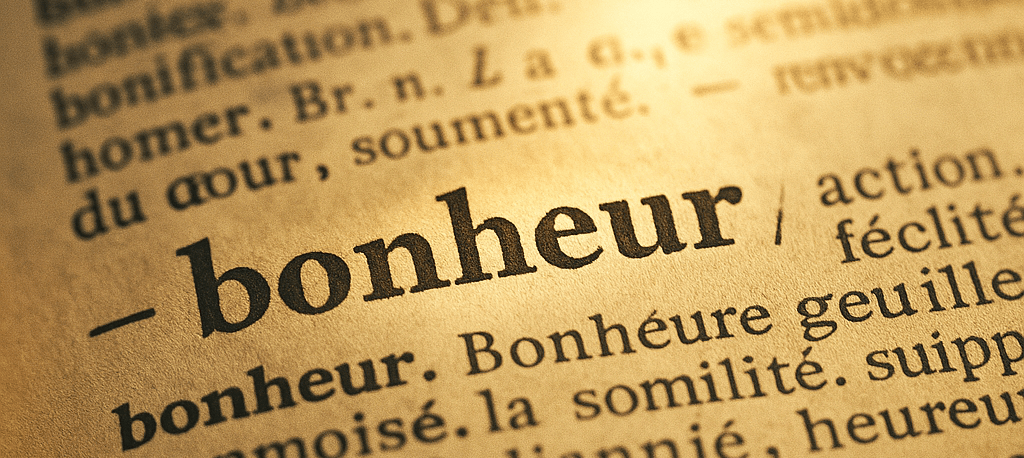
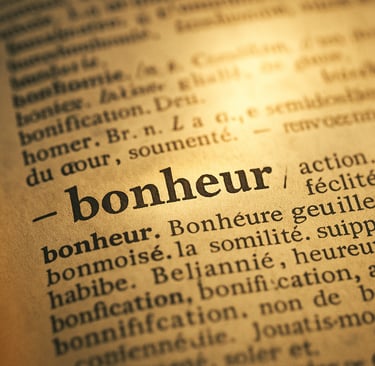
Un petit h, une grande histoire
Le mot bonheur semble si familier, qu’on en oublie son étrangeté : pourquoi ce h muet, planté au milieu de ce mot ? Il ne se prononce pas, ne change rien au sens… et pourtant, il est là, à se faire oublier comme un grain de beauté qu'on ne remarque même plus. Ce petit h aussi discret soit-il, cache en réalité une grande histoire de langue.
Avant le h : le “bon eür” du Moyen Âge
Avant d’être bonheur, le mot s’écrivait bon eür — en deux mots.
Eür venait du vieux français eur, lui-même issu du latin augurium, qui signifie présage ou signe favorable.
Autrement dit, avoir bon eür voulait dire avoir de la chance. Le bonheur, à l’origine, n’était pas un sentiment : c’était un coup du sort heureux, une rencontre entre l’homme et la chance.
Ce n’est que plus tard que le mot s’est chargé d’une valeur intime : la satisfaction du cœur, la paix intérieure. Notre bonheur moderne a donc commencé comme un simple clin d’œil du destin.
L’apparition du h : une coquetterie d’érudit
Alors, d’où vient ce h ?
Au XVIᵉ siècle, les copistes et les humanistes, fascinés par le latin, aimaient donner une allure savante aux mots français. Ils ajoutaient des lettres “silencieuses” pour rappeler leurs origines prestigieuses.
Le mot heur a donc reçu un h décoratif, inspiré du latin, un peu comme on met un accent circonflexe sur un mot pour lui donner du panache.
Ce h ne se prononce pas, mais il embellit le mot. Il le rend plus “lettré”, plus noble.
Bernard Fripiat, linguiste et chroniqueur à Télématin, résume cela avec humour :
“Le h français est un fantôme : il ne se prononce pas, mais il hante nos dictionnaires.”
Le h du bonheur : inutile, donc essentiel
Ce h ne sert à rien… sauf à exister. C'est la blague dans "Brice de Nice" lors d'une joute verbale, pour casser son adversaire, Brice lui cloue le bec avec cette phrase légendaire du cinéma : "t'es comme le H de Hawaï... tu sers à rien !"
Il est muet, mais il signale que la langue française se base autant sur la mémoire que sur la logique.
Le français aime ses lettres muettes : souvenirs d’un passé latin, traces d’une époque où l’écriture était un art. Et cet art aujourd'hui fait faire des fautes d'orthographe à nos jeunes élèves. C'est ballot !
Mais si le h du bonheur nous apprenait quelque chose de plus profond ?
Peut-être que le bonheur, lui aussi, est de cet ordre là : discret, invisible, mais essentiel. Car comme le disait Cyrano : "C'est bien plus beau lorsque c'est inutile". (Lisez Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand c'est un chef d'oeuvre)
Le glissement du bonheur
Au fil des siècles, bonheur s’est éloigné de sa signification originelle.
Le mot est passé du coup de chance au sentiment choisi (je dois être heureux).
Mais, l’étymologie continue de laisser son empreinte : le bonheur reste un hasard bienveillant. Il ne s’ordonne pas, il se reçoit.
Un mot à deux visages
Le h de bonheur ne se voit presque pas, mais il change tout. Un mot à deux visages : la chance et la grâce.
En fin de compte, le bonheur porte bien son nom : un mot façonné par le hasard, embelli par le goût, transmis par l’amour des lettres.
Et si ce h muet, invisible, était justement là pour nous rappeler que le bonheur, comme la langue française, n’a pas besoin de faire du bruit pour exister ?
📚 Sources :
Bernard Fripiat — chronique « Pourquoi y a-t-il un h à bonheur ? », Télématin (France 2)
Dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey, Le Robert
NEWSLETTER
Copyright © 2025 Campagnedesmots | Mentions légales | CGV
SUIVEZ-MOI
NAVIGATION
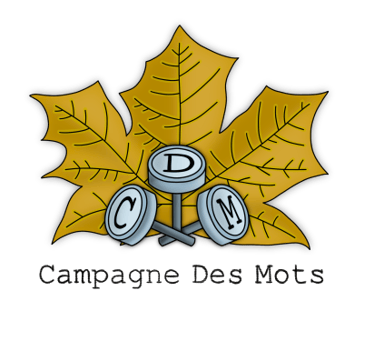
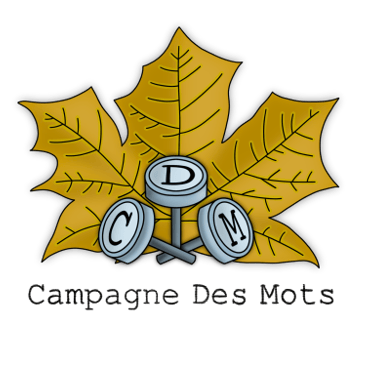
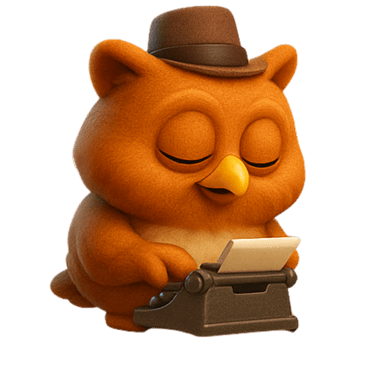
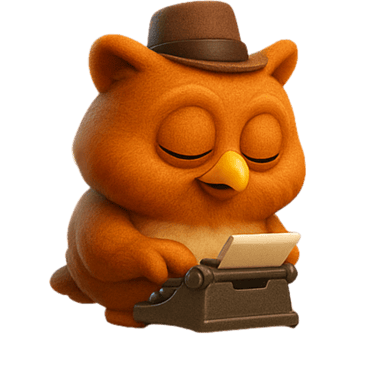
Pour recevoir des conseils d'écriture et bien plus encore....
